Un événement littéraire est passé presque inaperçu : la publication de l’intégralité de la correspondance de Madame de Maintenon – pas moins de 7 volumes ! Pour les Carnets de Versailles, Christine Mongenot, maître de conférence et universitaire ayant contribué à ce projet titanesque, dresse le portrait « mental » d’une épouse en quête d’une intimité contrariée, à l’ombre du Roi et de la vie de Cour.

Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon, par Pierre Mignard (1612-1695) © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Daniel Arnaudet
« Je suis née pour l’esclavage » : la formule qui clôt la lettre que Madame de Maintenon adresse le 14 mars 1711 à celle qu’elle appelle sa « petite nièce » – Madame de Caylus – porte la marque de son esprit railleur, réminiscence durable de l’époque où la veuve Scarron fréquentait au Marais, Madame de Sévigné et Madame de La Fayette. Mais lancée sous forme de boutade, la formule n’en recouvre pas moins une réalité assez durement éprouvée, en près de 28 années alors passées aux côtés de Louis XIV, si l’on se réfère à 1683, date supposée du mariage morganatique, voire en 37 ans, si l’on prend comme origine la venue à la Cour de celle qui n’est encore que la gouvernante dévouée d’enfants adultérins, légitimés en décembre 1673. L’ascension sociale de Françoise d’Aubigné, qui a le plus souvent fasciné les biographes, parce qu’elle active tous les ressorts d’un conte populaire, depuis l’origine obscure jusqu’à la reconnaissance éclatante, de la figure initiale et revendiquée de la petite gardeuse de dindons saintongeaise jusqu’à la stature imposante de l’épouse royale, se paie cependant d’un tribut personnel de la part de l’héroïne : une constante subordination aux contraintes de la vie à la Cour et à celles de la vie conjugale auprès d’un monarque qui n’entend pas plus renoncer à ses propres goûts, que déroger aux principes d’une étiquette instituant l’exposition publique et réglée des Grands.

Madame de Maintenon peinte (détail), par Louis Elle.
Si le tribut à payer s’alourdit indéniablement au fil du temps, il semble bien qu’il ait fortement coûté, dès l’origine, à celle dont l’ascension commence dans les années 1670 : au long d’une vie de cour en partie itinérante, au gré des déplacements que Louis XIV affectionne, pour l’essentiel entre Saint-Germain et Versailles, puis lors des résidences alternées entre Versailles et Marly et surtout lors des longs séjours d’été à Fontainebleau, l’existence de Madame de Maintenon s’accompagne de la négociation permanente d’un espace personnel, espace à la fois matériel, on le verra, mais aussi mental, qui permette d’être un peu à soi. Il serait donc faux de mettre le lamento railleur de la lettre de 1711, sur le seul compte de l’âge, et de l’usure, pourtant compréhensible chez une femme de 76 ans ; il est sans doute aussi injuste de refuser toute authenticité au désir d’intimité frustré, si récurrent dans la correspondance, et de suivre sur ce point les détracteurs de Madame de Maintenon : ceux-ci taxent ses propos de double discours et décèlent, sous les regrets exprimés, la marque de l’ambitieuse, habile à masquer ainsi les satisfactions d’amour propre obtenues.
Reconnaissons qu’éblouie par l’ascension en cours, la gouvernante a pu parfois succomber à quelques effets de vanité, comme lorsque, depuis Saint-Germain, elle écrit à son frère Charles, en 1678 :
« Jugez par mon style du peu de loisir que j’ai : il y a dans la chambre vingt personnes, trois enfants et six ou sept chiens. »
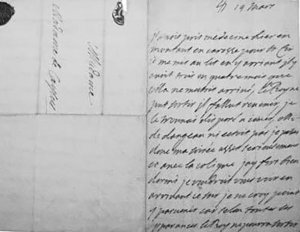
Lettre manuscrite de Madame de Maintenon datée du 14 mars 1711 . © Collection particulière, droits réservés
La foule qui encombre la chambre, n’est-elle pas en effet l’indice glorieux de la faveur qui grandit et s’expose ? Mais cette coquetterie une fois satisfaite, ce qui ressort rapidement de la vie à la Cour, dans les lettres des années 1680, devient bientôt l’expression d’une constante frustration, d’une contrainte épuisante. C’est, semble-t-il, à Versailles que la tension est la plus forte. L’espace dont Madame de Maintenon dispose est un lieu constamment envahi par la famille royale et par les Grands auxquels on ne saurait refuser le droit de séance : la présence des dames de la Cour, qui s’y ajoute, n’est d’ailleurs pas mieux ressentie par l’épouse du Roi qui dénonce ironiquement leur « volière », déjà « fatigante dans les temps où on n’a rien qui afflige » et agaçante par la propension féminine à juger de tout. Quoique femme elle-même, voilà notre marquise peu solidaire de cette espèce féminine « criant les hauts cris sur leur mari ou sur leurs enfants », prête à « brouiller les généraux » par les discours critiques tenus sur la manière de conduire la guerre d’Espagne et qui « agite[nt] s’il faut faire un traité ou non » en ajustant sa coiffure. C’est en moraliste que Madame de Maintenon considère sa servitude involontaire et évoque l’envahissement de son espace personnel par « une troupe de dames qui, écrit-elle, ne me laissent pas la liberté de faire ni ce que je devrais ni ce que je voudrais ». Mais, même s’il n’est pas occupé, l’espace n’appartient pas davantage à celle qui y réside, parce qu’il est constamment susceptible d’être « traversé », à Marly comme à Versailles : « Vous connaissez Marly et mon logement, écrit Madame de Maintenon à Madame des Ursins en 1707, le Roi était seul dans une petite chambre et je me mettais à table dans mon cabinet par lequel on passe ». Position stratégique, l’installation dans l’étroite proximité du monarque permet à son épouse d’accéder en temps réel aux nouvelles cruciales qui arrivent des fronts militaires.

Isabelle Huppert dans le rôle de Madame de Maintenon dans Saint-Cyr réalisé par Patricia Mazuy © Archipel 33
Mais cette position de témoin éminent au coeur du politique se paie à l’inverse par l’absence quasi complète d’espace privé. Si la quête d’un espace privé touche progressivement la société du XVIIe siècle, cette revendication est sans doute plus encore affirmée chez un personnage qui demeure à la Cour où, selon les principes de contrôle conçus par Louis XIV, chacun vit sous le regard de tous. Les contraintes qui pèsent sur tout membre de l’entourage royal, sont cependant plus profondément encore ressenties par l’épouse royale pour des raisons qui tiennent à sa formation comme à sa personnalité. Chez Madame de Maintenon, elles entrent en contradiction avec une forme d’autonomie qui a pu être expérimentée pendant la période de veuvage, après la mort de Scarron ; elles contreviennent aussi aux caractéristiques de la vie dévote qui, même conçue dans une perspective moderne impliquant l’action et la vie dans le monde, exige aussi des temps de retraite et des espaces de recueillement. Cette double tendance sera constamment contrariée : au temps de la faveur croissante, le goût pour l’autonomie se lit pourtant dans les aménagements que projette la nouvelle marquise pour la propriété de Maintenon qu’elle acquiert en 1674 : projet de « mettre une tringle dans ce petit trou où je prétends écrire », apprêts demandés pour la chambre où il s’agit d’installer une couchette, évocation d’un emplacement « du côté de l’armoire où sont mes livres » : « nous y mettrions, écrit cette Perrette d’un nouveau genre, un pavillon qui n’empêcherait pas que l’armoire ne servît ». L’aménagement de l’espace ainsi détaillé dit surtout un rêve qui ne sera jamais réalisé : vie de Dame campagnarde menant une existence dévote, occupée aux activités de lecture, d’écriture et de gestion de son petit domaine. Que les livres soient ces bonnes lectures qui servent à la méditation spirituelle ou ceux des comptes tenus par la gestionnaire attentive à son bien, l’espace est ici pensé pour une activité féminine sérieuse, une manière d’être occupée ou d’être à soi que Madame de Maintenon revendiquera toujours face à la futilité, à la dispersion de la vie mondaine.
Christine Mongenot,
Maître de conférences en littérature française Université de Cergy-Pontoise.
À VOIR