Le château de Versailles accueille cet été un artiste de la nature qui cherche à en reconstituer les mirages dans des installations proches de l’immatériel.
Portrait d’une star de l’art contemporain,
modeste comme un pasteur.

La Colonnade investie par Olafur Eliasson. © EPV / Thomas Garnier
« Je suis islandais pour les Danois et danois pour les Islandais ! » Né à Copenhague en 1967 de parents islandais, Elías Hjörleifsson et Ingibjörg Olafsdottir, jeunes émigrés au Danemark en 1966 comme apprentis cuisinier et couturière, Olafur Eliasson a déjà le nom d’artiste qui fait partir l’imagination au loin. Direction terre des volcans et « Île de glace » entre le Groenland et la Norvège, au nord-ouest des îles Féroé.
Évidemment, la plate Copenhague où il a grandi et les moraines glaciaires de l’île de Seeland où ondulent les moissons sont moins furieusement romantiques. Mais c’est tout l’art d’Olafur Eliasson que de garder à l’esprit ses racines extrêmes de l’Atlantique Nord et ses consonances exotiques héritées des paysages sans fin de lave et de glaciers. Puis d’y allier le sens de la mesure et le pragmatisme imparable qui font la force du petit royaume scandinave, des Contes d’Andersen aux aléas politiques de Madame le Premier Ministre dans la série TV, Borgen. Une étoile est née. Elle est écoresponsable, humaniste et d’une sauvagerie très contrôlée.

Olafur Eliasson, Your rainbow panorama on the roof of Museum of Modern Art in Denmark © Olafur Eliasson
Tous ces ingrédients pêle-mêle font le charme unique de son studio à Berlin qui lui ressemble selon les strictes lois de l’homothétie. Cette petite enclave nordique est organisée en une communauté exemplaire de près de 100 personnes – architectes, théoriciens, artisans, scientifiques, menuisiers, professionnels des médias et as des écrans, documentalistes, éditeurs, dessinateurs, maquettistes, cuisinières bio venues du Japon et des États-Unis – écologiquement et égalitairement rassemblées autour d’un seul but : l’avenir radieux du studio Olafur Eliasson, forme policée d’une utopie contemporaine.
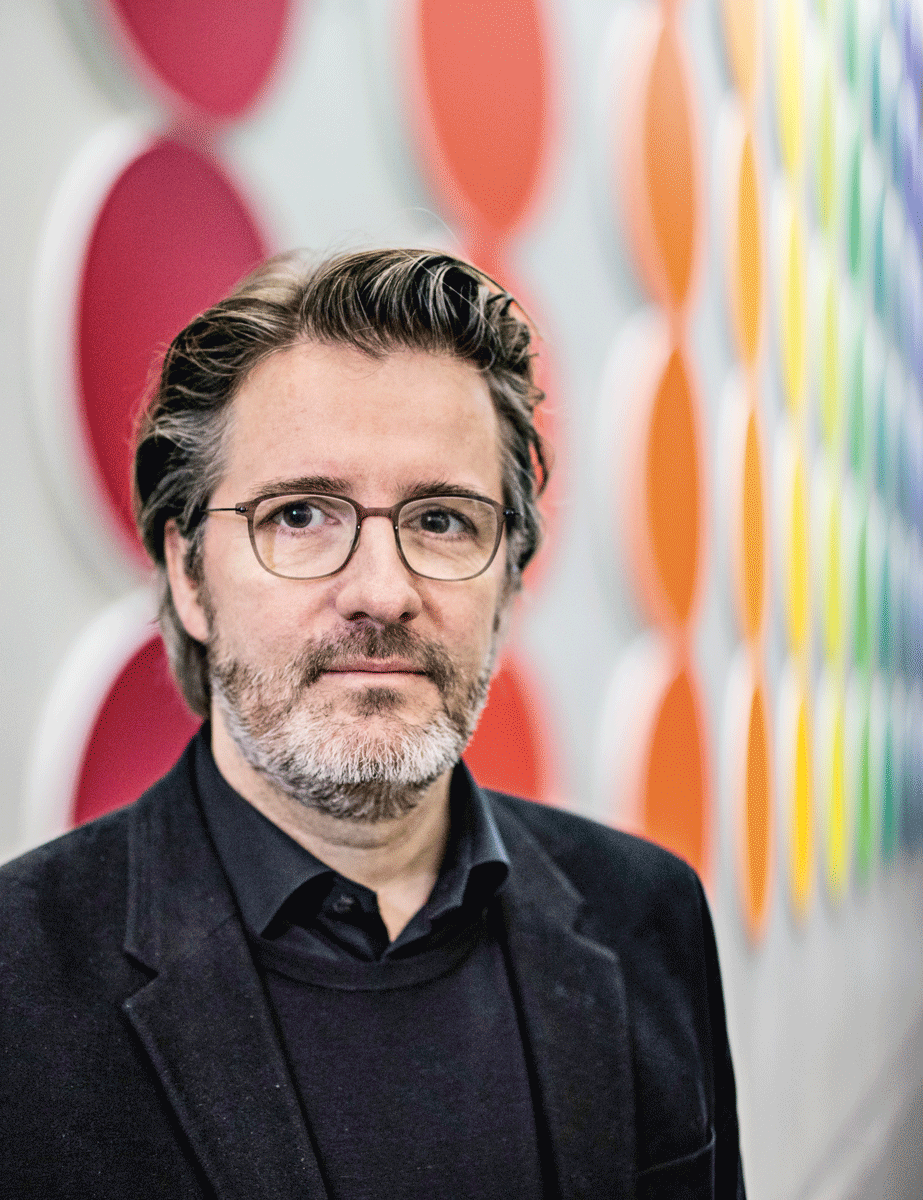
Portrait Olafur Eliasson. © Olafur Eliasson
À quoi ressemble le monde vu par un Viking ? À une question perpétuelle, pourrait-on dire tant ce barbu brun et hirsute comme Aragorn, l’« Arpenteur » de Tolkien, garde le même rapport taiseux aux choses et les yeux grand ouverts sur ce phénomène que l’on appelle la Terre. Il y a de l’enfant qui s’interroge sur le fonctionnement des systèmes, du corps microscopique jusqu’au tréfonds de l’univers.
La lumière est la matière première d’Olafur Eliasson qui a séduit le monde de l’art en 2003, en installant une aurore polaire à l’orangé pâle dans le Turbine Hall de la Tate Modern. Par un jeu de miroirs immenses, un demi-cercle lumineux devenait un soleil plein qu’un fin brouillard artificiel nimbait du mystère du premier matin. Spontanément, les Londoniens se couchaient pour l’admirer à même le sol en béton de l’ancienne centrale thermique devenue musée d’art contemporain et voyaient leur reflet de fourmis sur le plafond miroir devenu infini. Ce fut un triomphe médiatique et public.

Installation au bout de la galerie des Glaces. © EPV / Thomas Garnier
Bernard Arnault, le président du groupe LVMH, fit partie de ceux qui sont tombés dans le sortilège. Pour l’inauguration de la Fondation Louis Vuitton à Paris fin 2014, il lui confia le cœur de son cher monument dressé toutes voiles dehors par l’architecte Canado-Américain, Frank Gehry : dédale de 43 colonnes à la mosaïque miroitante, son péristyle jaune pâle du Grotto y est une installation pérenne, point de convergence d’un public qui y multiplie les selfies. Quelques mois plus tard, son installation Contact la prolongeait par une expérience cosmique à vivre dans les salles métamorphosées en Voie lactée, avec sol bombé, univers de matière noire et râpeuse et trait aveuglant de l’horizon vu de l’autre côté de l’Espace.

Olafur Eliasson, Wishes versus wonders, 2015 © Olafur Eliasson
La mise en équation de la vie sur Terre reste son moteur de recherche. Ses plus belles installations restituent cet étonnement existentiel qu’est l’homme planté comme un microbe sur la Planète Bleue. Est-il son hôte, un intrus ? Est-il pacifique comme un apôtre, guerrier comme un envahisseur descendu des terres froides vers la douce France et ses vergers ? Que veut-il garder de son passage éphémère sur ses pâturages, la beauté universelle ou la possession farouche de ses biens ? Comment voit-il ce qui l’entoure et en garde-t-il à l’esprit la valeur fragile ?
Anticipant la prise de conscience environnementale, soulignant par l’effet plastique le lien entre toutes choses, Olafur a teinté d’un vert symbolique et inoffensif les rivières de Moss en Norvège (1998), de Brême dans le nord de l’Allemagne (1998), de Los Angeles en Californie (1999), de Stockholm en Suède (2000) et de Tokyo au Japon (2001).

Olafur Eliasson : The New York City Waterfalls. © Olafur Eliasson
En 2008, The Public Art Fund lui a commandé quatre installations spectaculaires, The New York City Waterfalls, qui tentaient de reconstituer le théâtre des cascades glaciaires autour de l’île de Manhattan et de ses gratte-ciel. Le projet était fou, le prix aussi (15,5 millions de dollars, soit plus que pour The Gates, l’installation de Christo et de Jeanne-Claude à Central Park). Belle tentative, mais la « skyline » si puissante de New York fut plus forte.
« La mise en équation de la vie sur Terre reste son moteur de recherche. Ses plus belles installations restituent cet étonnement existentiel qu’est l’homme planté comme un microbe sur la Planète Bleue. »
Vrai phénomène de l’art contemporain facilement doré sur tranche, sans plus d’ostentation ou d’agressivité qu’un humble pasteur du Jutland, Olafur Eliasson garde à 48 ans le profil modeste derrière une aura de star. Il est pourtant prisé des collectionneurs XXL et autres milliardaires de la mondialisation. Du Brésil de Bernardo Paz, magnat de l’acier qui s’est bâti un musée pharaonique dans un parc paradisiaque à Inhotim, à une heure de Belo Horizonte, à l’Ukraine résolument moderne et frondeuse de Victor Pinchuk, renard des affaires classé dans la « Liste des 100 » du magazine Time en 2010 et mécène de Kiev. Question d’échelle, de moyens et de contexte.
Une rétrospective monumentale, entre le Futuroscope surdimensionné et le laboratoire bricolé de Géo Trouvetout, vient de s’ouvrir au Long Museum de Shanghai (Chine) et a fait courir le petit monde de l’art depuis la dernière foire d’Art Basel Hongkong jusqu’à cet énorme complexe industriel de Pudong transformé en musée d’art contemporain, impeccable « White Box ». Elle succède à l’exposition « Baroque Baroque » au Palais d’hiver du Prince Eugène à Vienne (Autriche), plus subtile, plus conceptuelle, qui mettait sobrement en scène les pièces historiques – souvent immatérielles comme l’aube, le vide et le plein, le vent, le silence et la vibration des ondes – de la collection pionnière de l’Archiduchesse d’Autriche, la flamboyante Francesca de Habsbourg.
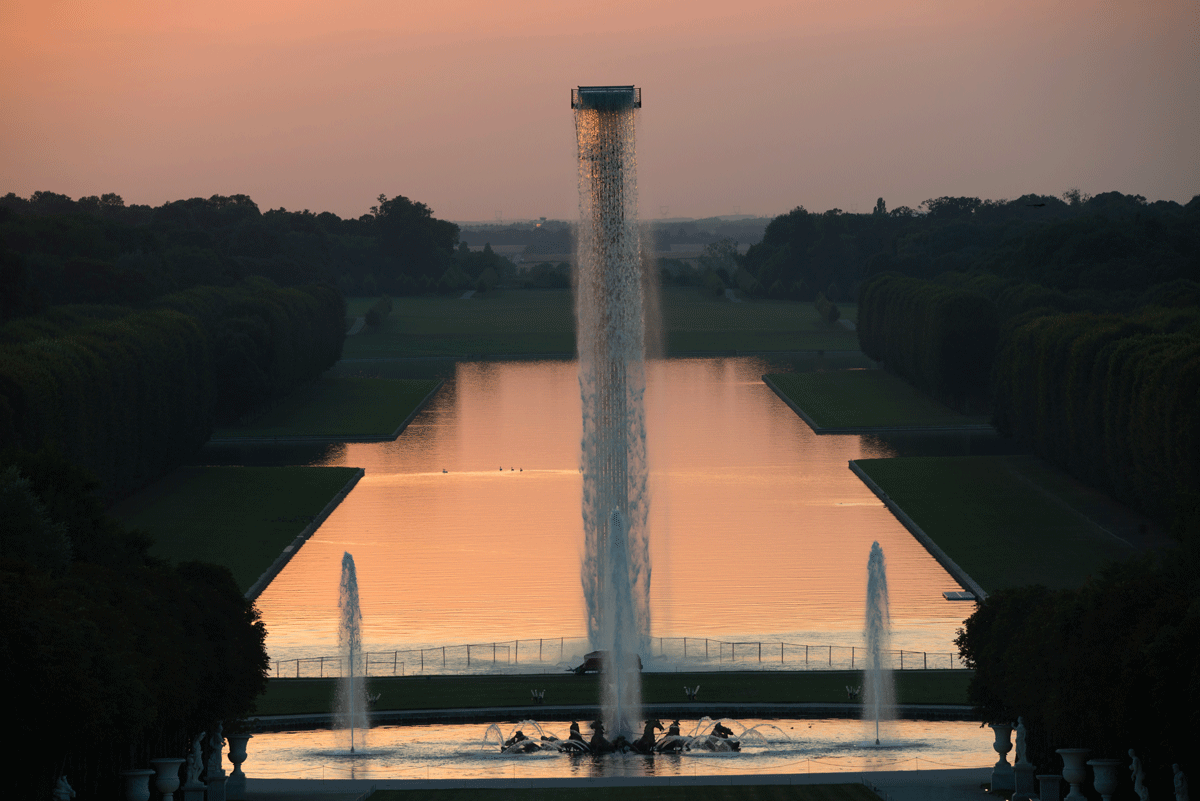
Installation devant le Grand Canal à l’occasion de l’exposition. © EPV / Thomas Garnier
La France le connaît bien grâce à Suzanne Pagé, aujourd’hui directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton, alors téméraire directrice du Musée d’art moderne de la Ville de Paris où, en 2002, le jeune Olafur Eliasson avait recouvert le sol de laves ocres. Pendant la Cop21, malgré le poids des attentats du 13 novembre, ce militant de la nature avait réussi à disposer en cercle son cadran polaire, Ice Watch Paris, 12 énormes blocs de glacier du Groenland, en une nuit épique d’installation sur la Place du Panthéon. La fonte inexorable de cette glace pure comme le diamant était la démonstration claire et nette du réchauffement climatique et soulignait ses enjeux pour l’humanité.
La polémique instantanée du web sur la facture carbone de ce projet écolo ne l’a pas refroidi. « J’ai trouvé qu’il y avait là de bons arguments et je les ai écoutés attentivement », a-t-il répondu calmement au Figaro. « La facture carbone d’Ice Watch Paris correspond à celle induite par le voyage de 30 enfants entre Paris et le Groenland. Les gens ont raison de dénoncer toute pollution, je n’ai rien contre cette attitude qui allait aussi dans l’idée de notre projet, même si elle le critiquait. Mais l’art n’est ni quantifiable, ni fonctionnel. Ce n’est pas la même mesure ». Versailles hérite donc d’un homme passionné d’art, de nature mais aussi de dialogue.
Valérie Duponchelle,
Grand reporter Arts au journal Le Figaro
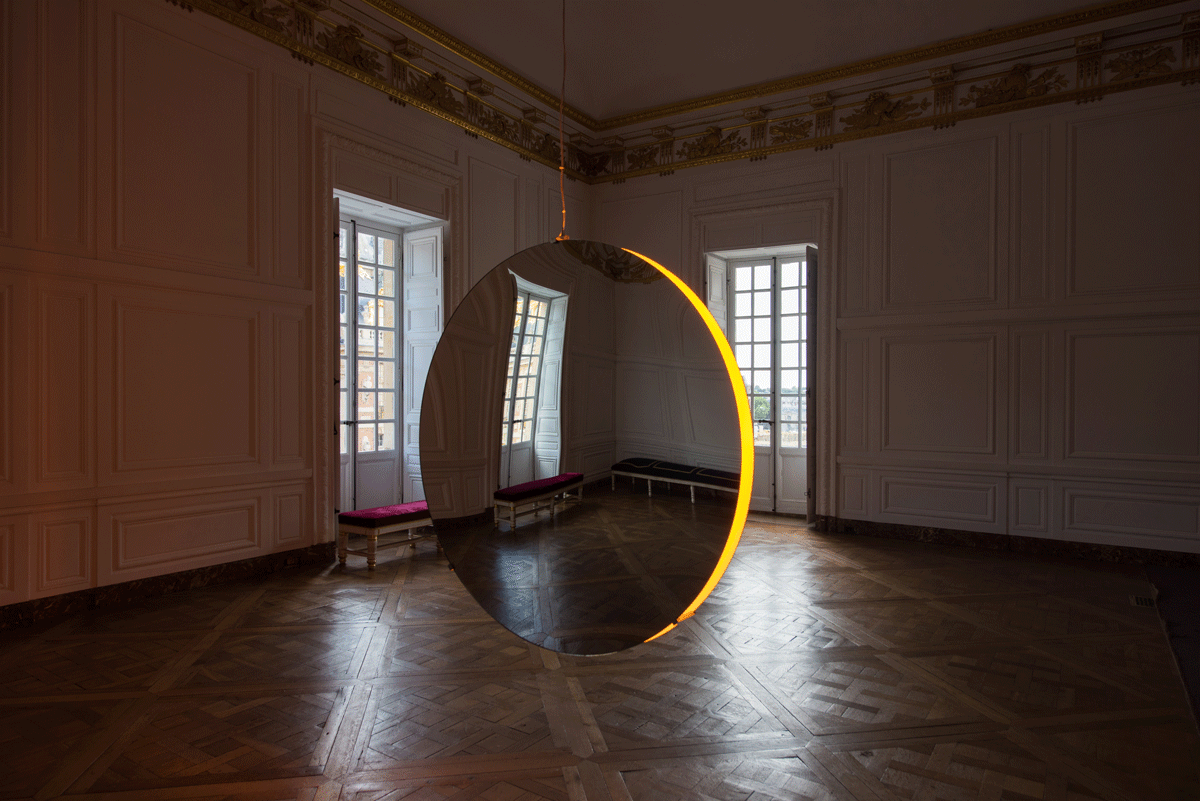
Effet de miroir dans une pièce du château. © EPV / Thomas Garnier