Ce dessin, rare et spectaculaire, est très probablement un projet de trône pour Louis XIV dont l’histoire exacte est encore à retracer.
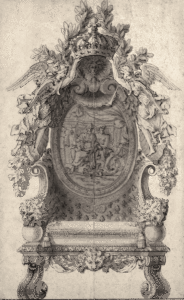
Étude pour le fauteuil de trône sculpté de Louis XIV, anonyme, années 1680, dessin à la plume et à l’encre noire, 25,3 × 15,4 cm, musée national
des châteaux de Versailles et de Trianon. © EPV / Christophe Fouin
Le trône est habituellement considéré comme l’expression du pouvoir monarchique, mais ce n’est pas le cas à Versailles, où il n’est entouré d’aucune marque de respect particulière. Le mot désigne tantôt le siège, tantôt l’estrade, tantôt l’ensemble ; on utilise également les termes de « fauteuil », de « grand fauteuil », de « fauteuil extraordinaire » ou de « grand fauteuil extraordinaire », mais aussi, tout simplement, de « chaise ».
De la réputation du trône d’argent
Plusieurs trônes ont été réalisés pour Louis XIV : le premier, en 1669, pour le château de Saint-Germain, puis deux autres, en 1670 et 1672, pour les Tuileries, mais le plus célèbre est, sans aucun doute, le « trône d’argent », utilisé à Versailles à partir de 1681. Il s’agit, en réalité, d’un fauteuil sculpté en bois argenté, orné par l’ébéniste Domenico Cucci de figures d’argent réutilisées : quatre enfants aux corbeilles sur des dauphins, livrés par Ballin en 1669, et trois figures d’Apollon, de la Force et de la Justice, payées en 1664 à la « dame Verbeck1 ». Ces sculptures d’argent ayant été envoyées à la fonte dès décembre 1689, Louis XIV n’utilise plus, après 1690, qu’un « fauteuil à l’ordinaire », sculpté et doré, surmonté de deux génies tenant une couronne.
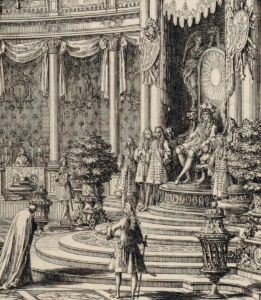
Audience donnée par le roi aux ambassadeurs de Siam dans les appartements de Versailles [détail], par Sébastien Leclerc, XVIIe siècle, tiré du recueil des Estampes relatives à l’Histoire de France, t. 61, vers 1684-1685. © Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF) / Estampes et photographie
Le trône ne servait au souverain que très rarement, à l’occasion des réceptions d’ambassades lointaines. Il ne fut placé que trois fois dans la Grande Galerie, pour accueillir le doge de Gênes (15 mai 1685), les ambassadeurs du Siam (1er septembre 1686) et l’envoyé de Perse (19 février 1715).
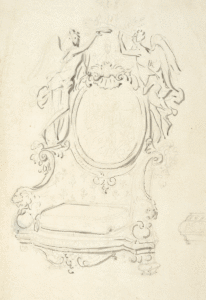
Étude d’un trône d’argent pour Louis XIV : Study of a Massive Silver Throne for Louis XIV, anonyme français,
s. d., Stockholm, Nationalmuseum. © Stockholm, Nationalmuseum / Cecilia Heisser
La proposition d’un artiste des Gobelins ?
Ce dessin pour un trône est inédit. Les éléments qui le composent indiquent un modèle destiné à Louis XIV : « semé fleur-de-lysé », couronne fermée sommitale, soleil apollinien, figures de la Justice et la Force dans le médaillon du dossier… Il peut être rapproché d’une gravure de Sébastien Leclerc où figurent deux grands génies tenant une palme. On peut le dater des années 1680, mais le contexte de sa création demeure incertain. Les archives suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une proposition faite par l’un des artistes œuvrant aux Gobelins : un projet pour le trône d’argent, datant de 1680, par le peintre François Bonnemer, ou bien pour un second trône, à la fin de la décennie, alors que la manufacture commence à fournir des consoles en bois doré pour la galerie des Glaces, moins onéreuses qu’un mobilier d’argent. Des recherches, qui s’annoncent passionnantes, permettront peut-être d’en savoir plus.
Élisabeth Maisonnier,
conservateur en chef au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon,
responsable du cabinet des Arts graphiques
1 Madeleine Verbeck fournit fréquemment la Cour en pièces d’orfèvrerie dans les années 1660-1670. Elle agissait comme marchande, achetant ou faisant faire les pièces, et non comme orfèvre.
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°25 (octobre 2024 – mars 2025).